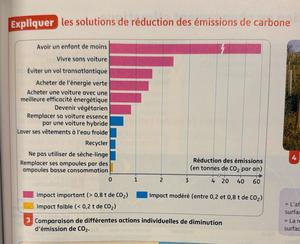« L'euthanasie est une religion d'État » : entretien avec le Père Laurent Stalla-Bourdillon
Photo de Sebabor/CC BY-SA 4.0
Prêtre du diocèse de Paris, le Père Laurent Stalla-Bourdillon a exercé pendant six ans la fonction d’aumônier des parlementaires, un poste clé pour le dialogue entre l’Église et la sphère politique à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Il est actuellement directeur du Service pour les Professionnels de l’Information. Ces fonctions successives lui ont offert un observatoire privilégié pour porter un regard chrétien sur le monde politique français. Il a récemment publié deux ouvrages sur les questions de la mort et de l’euthanasie : La mort n’est pas ce que vous croyez, 2024, DDB et L’euthanasie, une religion d’État qui ne dit pas son nom, 2025, Téqui.
Le débat politique actuel
1/ Avant le vote du Sénat sur la loi Fin de vie, on a eu l’impression que le débat était verrouillé et téléguidé et que ni les députés, ni le Gouvernement, n’écoutaient les alertes des soignants et des religions sur les risques d’une loi euthanasie sans garde-fou. Vous qui avez côtoyé de près le monde politique, trouvez-vous qu’une discussion contradictoire authentique soit possible ? Les conditions d’un débat où la vérité est recherchée sont-elles réunies ?
Il est difficile aujourd’hui de parler de « débat » quand l’issue semble décidée d’avance et que le cadre même de la discussion exclut certaines questions de fond. Un vrai débat suppose que personne ne se considère comme propriétaire de la vérité, que les mots soient clairement définis, que les objections sérieuses soient entendues et non disqualifiées comme « rétrogrades » ou « confessionnelles ». Or, sur la fin de vie, beaucoup de responsables politiques n’entrent plus dans une recherche commune du vrai et du juste : ils gèrent des équilibres d’opinion, des calendriers électoraux, des promesses à tenir. On consulte des soignants ou des représentants religieux, mais souvent pour la forme, sans que leurs alertes soient réellement prises en compte dans la loi. Pour qu’un débat authentique soit possible, il faudrait accepter de mettre sur la table ce qui est en jeu anthropologiquement : qu’est‑ce qu’une personne ? qu’est‑ce qu’une vie digne ? quel type de société voulons‑nous ? Tant que ces questions restent verrouillées, la procédure peut être correcte, mais la recherche de la vérité, elle, ne l’est pas.
« Un vrai débat suppose que personne ne se considère comme propriétaire de la vérité, que les mots soient clairement définis, que les objections sérieuses soient entendues et non disqualifiées comme « rétrogrades » ou « confessionnelles ». »
2/ Vous dénoncez les manœuvres de certains politiques qui vont jusqu’à dénaturer le sens des mots. Comment, en tant que catholiques, se positionner et agir face à un monde où le mensonge et le calcul politique l’emportent sur la recherche de vérité ? Comment témoigner dans les débats publics ?
Quand le pouvoir joue avec les mots – « aide à mourir », « compassion », « ultime liberté » – pour rendre acceptable ce qui, en réalité, est la mise à mort d’un être humain, le risque pour les chrétiens serait de répondre par des slogans inverses ou par l’indignation seule. La tradition biblique invite plutôt à une clarté patiente : nommer les choses par leur nom, expliquer calmement pourquoi certains mots sont trompeurs, montrer avec des exemples concrets ce que produit une telle loi dans les hôpitaux, les familles, les consciences. Témoigner, c’est refuser de consentir au mensonge tout en restant disponible au dialogue. Le chrétien se souvient que la vérité n’est pas une arme mais une personne : il s’agit d’éclairer les consciences. Cela passe par la formation (comprendre les enjeux), par la parole publique (tribunes, interventions locales, présence dans les consultations), et par des gestes de proximité avec les personnes malades et en fin de vie, qui rendent visible ce que signifie vraiment accompagner, sans supprimer la personne qui souffre.
La mort et l’euthanasie
3/ Vous dénoncez une « censure de l’éternité » dans notre société. Pourquoi la mort est-elle devenue un sujet tabou, même pour les croyants ?
En effet, notre société vit une forme de « censure de l’éternité » : tout ce qui rappelle la finitude est refoulé, anesthésié, recouvert de discours techniques ou d’images rassurantes. La mort est évacuée des maisons, des conversations ordinaires, confiée aux professionnels comme un problème à gérer. Même les croyants subissent cette culture : ils vivent dans le même bain d’images, les mêmes injonctions à rester « performants » et autonomes jusqu’au bout. On ose de moins en moins dire ce que la mort signifie d’un point de vue spirituel et on se limite à la dimension organique. Elle pose une question de sens (comme signification et comme direction) à laquelle ni la médecine ni le droit ne peuvent répondre. La foi chrétienne, elle, ne nie pas l’angoisse de mourir mais elle l’ouvre sur une promesse : nous ne devenons pas « rien », nous allons vers quelqu’un. Là où l’éternité est passée sous silence, la mort devient un scandale absurde ; là où l’éternité est annoncée, la mort peut redevenir un passage, certes redoutable, mais habité.
4/ A contre-courant du matérialisme, vous présentez l’être humain comme un « être en devenir » par sa mort même. Qu’entendez-vous par là et comment cela permet-il de se disposer à bien mourir ?
Dire que l’être humain est un « être en devenir » jusque dans sa mort, c’est refuser de réduire la vie à la somme de nos sensations présentes. Nous ne sommes pas seulement ce que nous éprouvons aujourd’hui : nous sommes en chemin vers un accomplissement que nous ne voyons pas encore. La mort, dans cette perspective, n’est pas la défaite de la vie mais le moment où elle se remet entièrement entre les mains de Dieu. S’y préparer, ce n’est pas rêver d’une « belle mort » idéale, sans souffrance ni dépendance, mais c’est entrer progressivement dans une attitude d’abandon confiant : accepter de ne plus tout maîtriser, pardonner, demander pardon, dire merci, recevoir les sacrements. Une société qui reconnaît l’être humain comme être en devenir aide chacun à vivre ce passage comme un acte, non comme une pure passivité : l’ultime geste libre par lequel je confie ma vie à Celui de qui je la tiens, au lieu de la reprendre à mon compte en décidant moi-même de ma disparition.
« Entre générations, la confiance se fissure : au lieu d’être sûrs d’être accompagnés coûte que coûte, les plus faibles se demandent s’ils ne devraient pas « dégager » pour soulager les autres. »
5/ En quoi l’euthanasie, sous couvert de liberté individuelle, finit-elle par détruire le tissu social et la solidarité entre les générations ?
Sous couvert de liberté individuelle, l’euthanasie introduit une logique nouvelle : il existe des vies dont on peut disposer, dès lors qu’elles ne correspondent plus aux critères dominants de qualité, d’autonomie, d’absence de souffrance. Cela ne concerne pas seulement la personne qui demande la mort, cela rejaillit sur tout le tissu social. Les plus fragiles – personnes âgées, handicapées, malades chroniques – intériorisent peu à peu l’idée qu’ils « coûtent » trop, qu’ils font peser un fardeau sur leurs proches ou sur la collectivité. La pression implicite à ne pas déranger devient très forte. Entre générations, la confiance se fissure : au lieu d’être sûrs d’être accompagnés coûte que coûte, les plus faibles se demandent s’ils ne devraient pas « dégager » pour soulager les autres. Une société qui autorise la mise à mort par compassion rompt avec l’intuition la plus élémentaire de la solidarité : on ne protège plus inconditionnellement les plus fragiles, on évalue si leur vie vaut encore d’être vécue. Nous avons oublié que nous vivions tous dans un corps social. Les conséquences de sa fragilisation sont imprévisibles. Qui sera là pour défendre ce « corps commun » ? L’Eglise s’y engage inlassablement.
6/ Comment une société fondée sur la « culture de vie » chère à Jean-Paul II devrait-elle concrètement accueillir la mort ?
« Une société inspirée par la « culture de vie » ne nie pas la mort, elle la regarde en face et organise tout pour qu’aucun mourant ne soit abandonné. Concrètement, cela veut dire : développer vraiment les soins palliatifs, former les soignants et les familles à l’accompagnement, garantir une présence humaine au chevet, même quand la médecine ne peut plus guérir. »
Cela veut dire aussi laisser une place aux rites, à la prière, aux sacrements, à l’accompagnement spirituel, au temps de silence. Au lieu de promettre de supprimer la souffrance en supprimant le souffrant, on cherche à soulager la douleur, à apaiser l’angoisse, à entourer la personne de signes qu’elle reste aimée et digne jusqu’au bout. Dans une culture de vie, la mort n’est pas un échec technique mais un moment de vérité : celui où une existence se remet entre les mains de Dieu et de ceux qui l’aiment. La question n’est plus : « comment en finir ? », mais : « comment rester fidèles à la vraie grandeur de celui qui s’en va ? ».
La nouvelle « religion d’État » et les enjeux de civilisation
7/ Vous qualifiez l’euthanasie de « religion d’État ». Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau dogme que l’on tente d’imposer aux Français ?
Parler de l’euthanasie comme « religion d’État », c’est constater qu’elle porte désormais un ensemble de dogmes, de rituels et de promesses qui structurent l’imaginaire collectif. Les dogmes sont l’idée que l’autonomie individuelle est absolue, que la vie n’a de valeur que si elle répond à certains critères de qualité, que la souffrance est le mal suprême qu’il faut éliminer à tout prix. Les rituels relèvent d’une procédure juridique et médicale qui ressemble à une liturgie laïque, avec des autorités (comités, médecins, juges) qui donnent ou non le « sacrement » de la mort. La promesse enfin de cette religion d’État, est celle d’une mort maîtrisée, indolore, presque propre, où l’on resterait jusqu’au bout sujet de sa vie. Quand l’État entérine cette vision et l’impose comme horizon légitime pour tous, il se substitue à la tradition religieuse pour dire ce qu’est une « bonne mort ». Il ne se contente plus de tolérer des pratiques ; il consacre une nouvelle croyance collective dans l’idée d’un être humain dépouillé de sa vocation à la communion divine.
8/ Vous affirmez que l’euthanasie rompt avec notre civilisation en instituant cette « religion d’État ». Mais la rupture n’est-elle pas plus ancienne ? Déjà la légalisation de l’avortement en France en 1975 était une rupture anthropologique majeure. La Révolution française elle-même n’était-elle pas déjà porteuse d’une « religion d’État » dont l’objectif était de remplacer le catholicisme ? Dès lors, où situer cette rupture civilisationnelle ? En quoi l’euthanasie marque-t-elle une étape nouvelle et peut-être plus radicale encore dans cette déconstruction de notre civilisation ?
Il est vrai que la légalisation de l’avortement, la dissociation systématique de la sexualité et de la procréation, ou encore certaines idéologies issues de la Révolution ont déjà entamé notre vision chrétienne de l’Homme. Mais l’euthanasie marque une étape nouvelle, parce qu’elle touche le lien le plus élémentaire : celui qui nous relie à toute personne humaine, quoi qu’elle ait fait, quel que soit son état. Avec l’avortement, la société a commencé à dire : certains commencements de vie peuvent être supprimés. Avec l’euthanasie, elle dit désormais : certaines fins de vie peuvent l’être aussi, au nom de la compassion. On passe d’une transgression tolérée à une norme culturelle qui redéfinit ce qu’est mourir « dignement ». En ce sens, l’euthanasie parachève un long processus : la sortie d’un horizon où la vie est reçue comme un don, pour entrer dans un monde où elle devient un matériau que chacun, avec l’aval de l’État, peut gérer jusqu’à son terme. On suppose ici que personne ne sera comptable de rien dans sa vie, c’est le rêve de l’autoréférence. Cela pourrait ne pas être aussi simple que cela.
9/ Quand on regarde le temps long de la déchristianisation en France, on a l’impression que toutes les barrières éthiques finissent par sauter et que la déchristianisation est inéluctable. Il y a quelque chose de décourageant pour les chrétiens. Quels messages d’espérance pouvez-vous adresser aux catholiques face à cela ?
Vu de loin, la déchristianisation ressemble à une grande marée qui emporte une à une les digues éthiques, et l’on pourrait se décourager. Pourtant, l’histoire de l’Église rappelle que la foi ne s’identifie jamais à un régime juridique ou à une culture dominante. Le christianisme est né minoritaire, souvent incompris, parfois persécuté, et c’est alors qu’il a le mieux témoigné de la valeur inconditionnelle de chaque personne. L’espérance chrétienne ne repose pas sur la solidité des lois, mais sur la fidélité de Dieu : aucune époque, aussi sécularisée soit‑elle, ne peut empêcher le Christ de rejoindre les cœurs, ni l’Esprit de susciter des témoins. Notre responsabilité n’est pas de « sauver la civilisation » par nos seules forces, mais de vivre de manière crédible l’Évangile de la vie là où nous sommes : dans nos familles, nos professions, nos engagements. Comme le disait tout récemment, Mgr Hicks, nouvel archevêque de New York, « l’Église catholique n’est pas un club privé. Un club existe pour servir ses membres. L’Église existe pour aller à la rencontre de tous et les servir. Nous existons pour suivre Jésus qui a nourri les affamés, guéri les malades, rejeté la haine et proclamé l’amour. »
Il rejoint l’encouragement du Pape Léon XIV, qui écrivait : « une Eglise qui ne met pas de limites à l’amour, qui ne connaît pas d’ennemis à combattre, mais seulement des hommes et des femmes à aimer, est l’Eglise dont le monde a besoin aujourd’hui ». (Dilexi Te, n°120). Chaque personne accompagnée jusqu’au bout, chaque geste de miséricorde posé auprès d’un mourant, est déjà une victoire de la Résurrection au cœur d’un monde qui l’a oubliée.
P. Laurent Stalla-Bourdillon